On constate les conséquences des changements climatiques, dont certaines sont surprenantes. Le Cycas du Japon fleuri dans de nombreux endroits qui ont un climat chaud à travers le monde. En Europe, cette plante était absente depuis 60 millions d’années. Avec le climat qui se réchauffe, cette plante semble vouloir se reproduire au Royaume-Uni
Nuage
Une plante préhistorique pourrait se reproduire dans le nord de l’Europe pour la première fois de l’histoire de l’humanité
Un cycas femelle (à gauche) et un cycas mâle. | Ventnor Botanic Garden
Julien Claudet
Les Cycadophytes sont en pleine reproduction à travers le monde, et elles pourraient être sur le point de se reproduire également au Royaume-Uni, pour la première fois de l’histoire de l’humanité. Les experts pensent que le changement climatique pourrait en être la cause.
Le Cycas du Japon (Cycas revoluta), une plante en forme de palmier de la famille des Cycadophytes, originaire des îles Nansei et des îles Ryūkyū au Japon, peut fleurir dans de nombreux endroits à travers le monde, mais elle ne se reproduit spontanément que dans des climats chauds. Cependant, dans le jardin botanique Ventnor sur l’île de Wight, au large de la côte sud de l’Angleterre, des cycas pourraient bien être sur le point de fleurir comme jamais auparavant.
Récemment, des cônes mâles et féminins sont apparus sur des Cycas revoluta (floraison), ce qui n’a jamais été vu auparavant au Royaume-Uni. Les botanistes locaux espèrent donc profiter de l’occasion pour faire se reproduire les plantes en effectuant un transfert de pollen. Il faut savoir que les cycas sont des plantes arborescentes : elles se présentent sous forme d’arbre.
« Fait intéressant : à l’époque, les cycas vivaient dans la région qui allait devenir l’île de Wight, des fossiles de cycas ont été découverts dans les falaises de la côte ouest de Wight », a écrit Liz Walker, du jardin botanique, dans un communiqué publié sur leur site web. « Par conséquent, les cycas sont absents de la région depuis 120 millions d’années ».
« Cela peut être considéré comme une preuve supplémentaire, provenant du règne végétal, du changement climatique en action », a-t-elle ajouté. « Ce type de plante ne pouvait certainement pas être considérée comme rustique au Royaume-Uni ; la récente vague de chaleur a contribué à la croissance de leurs cônes ».
Les experts pensent que les cycas sont absents du nord-ouest de l’Europe depuis environ 60 millions d’années, ce qui donne une idée de l’exception de l’événement, et montre bien à quel point les températures changent à travers le monde.
Juillet 2019 a vu les températures les plus élevées jamais enregistrées dans le monde (avec un pic de 38.7 degrés Celsius au Royaume-Uni). Et nous savons que de nombreuses autres régions du monde se réchauffent constamment.
« Les conditions doivent être en train de s’améliorer pour les plantes, ou de déclencher la recherche d’un mâle et d’une femelle en même temps », a déclaré à Earther John Curtis, directeur du Ventnor Botanic Garden. « Pour nous, c’est juste un symptôme du changement climatique. Ce sont les plantes qui nous parlent et répondent à ces conditions favorables ».
L’île de Wight est l’une des régions les plus douces du Royaume-Uni, et le personnel du jardin botanique annonce que les températures les plus basses de janvier sont maintenant en moyenne supérieures à ce qu’elles étaient il y a 100 ans.
C’est un changement qui permet à un type de plante différent de survivre à l’hiver. Chris Kidd, conservateur du jardin botanique de Ventnor, estime que le site est un “prédicteur” de ce que sera la Grande-Bretagne dans 20 ou 30 ans.
Cette découverte est passionnante pour les botanistes britanniques, mais elle ne change rien à leur vision “d’état d’urgence” provoqué par le changement climatique.



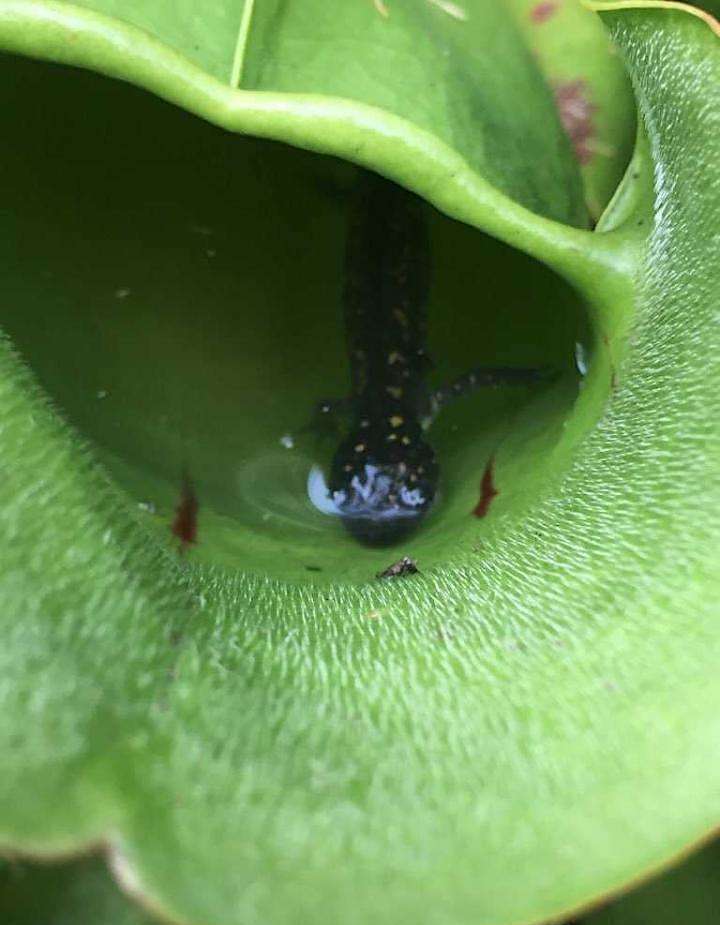
 Crédits : Andrew
Crédits : Andrew










